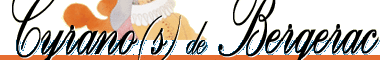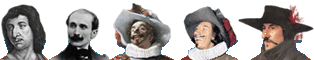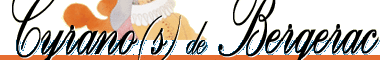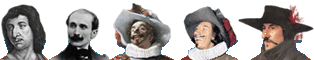Après Anouilh et Sartre, Jean-Marie Apostolidès fait ici, spécialement pour nous, le lien entre Alphonse Daudet et Edmond Rostand.
Alphonse Daudet mourut en évoquant Cyrano de Bergerac, qu'il s'apprêtait à aller applaudir quelques jours plus tard avec son épouse, lors de cette fameuse création restée dans la mémoire de tous ceux qui y assistèrent.
Triomphe pour l’un, four pour l’autre
Au-delà de l'anecdote, peut-on entrevoir quelque chose de plus entre les deux hommes, ou plutôt entre leurs deux pièces les plus fameuses? Rappelons d'abord que si la comédie héroïque de Rostand connut immédiatement le succès, le chef-d'œuvre théâtral de Daudet, L'Arlésienne, fut d'abord un four, lors de sa création au théâtre du Vaudeville, le 1er octobre 1872. Même la musique de Bizet ne fut pas épargnée. Le pompeux Francisque Sarcey, qui va hurler de joie vingt-cinq ans plus tard lors de la première de Cyrano, ne ménage pas ses sarcasmes à Daudet. Son éreintement débute ainsi: « L'Arlésienne ne ferait pas un bon opéra: le malheur est qu'elle ne fasse pas un meilleur drame. Je commence à croire que décidément M. Alphonse Daudet, ce charmant esprit, n'est pas né pour le théâtre. La donnée qu'il a choisie, où il s'est acharné, montrerait seule à quel point il manque de sens dramatique. »
L'échec de sa pièce incite Daudet à abandonner le théâtre, même s'il y revient plus tard, toujours traumatisé par l'incompréhension du public à ses débuts. «C'est très malheureux, écrivit-il à ce propos, parce que je croyais vraiment n'avoir rien écrit de plus profond... et je me demande même si, un jour, je pourrai faire mieux. » La pièce fut reprise au Théâtre de l'Odéon, sous la direction de Porel, le 5 mai 1885. Lors de cette reprise, elle connut enfin le succès, mais l'imbécile Sarcey, pour ne pas se déjuger, continua à chercher les mauvaises raisons pour lesquelles le public ne suivait plus son jugement éclairé. Ce que l'Oncle ridicule reprochait à la pièce de Daudet, c'est de n'avoir pas montré le personnage principal, alors que c'est ce coup d'audace qui nous rend aujourd'hui le drame si poignant et si novateur.
Le mythe de la femme fatale
Précurseur de Freud dans plusieurs de ses œuvres, Alphonse Daudet nous prouve ainsi que L'Arlésienne, l'amour absolu, n'existe pas. Il s'agit d'un fantasme masculin, lié au personnage de la mère, inventé dans ce drame autant par le gardian Mitifio que par Fréderi, le fils de Rose Mamaï. A cette hauteur de vue, on peut comparer cette pièce au chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, Vertigo, dans lequel Madeleine Elster n'existe pas plus que la belle fille d'Arles. Ici encore, il s'agit d'un fantasme masculin, d'abord initié par Gavin Elster, puis développé par Scottie Fergusson, qui tient dans ce drame un rôle équivalent à celui de Frederi, dans le drame de Daudet.
Le rapprochement entre Daudet et Rostand nous autorise à regarder d'un autre œil Cyrano de Bergerac. En effet, plus qu'un être de chair, Roxane appartient elle aussi à la famille des Arlésiennes, ces femmes fascinantes et irréelles, qui naissent du désir masculin. Cyrano autant que Christian l'a littéralement inventée. C'est un fantasme (né de l'imagination romantique de Rostand) que les deux protagonistes masculins ont créé, comme un lien indéfectible entre eux, et qu'ils invitent le public à partager. Si l'on prend Roxane pour un personnage vrai, on est frappé par son aveuglement et souvent par sa niaiserie; mais si on la rapproche de L'Arlésienne, que Daudet rend invisible pour mieux souligner son origine fantasmatique, alors nous sommes à même de comprendre qu'elles relèvent l'une et l'autre du mythe de la Femme fatale, qui structure l'imaginaire bourgeois dans la seconde partie du XIXe siècle, et sans doute encore au cours du siècle suivant.
Jean-Marie Apostolidès est romancier, essayiste, auteur dramatique, metteur en scène et professeur de littérature et théâtre à l’Université de Stanford aux Etat-Unis.
Du même auteur :